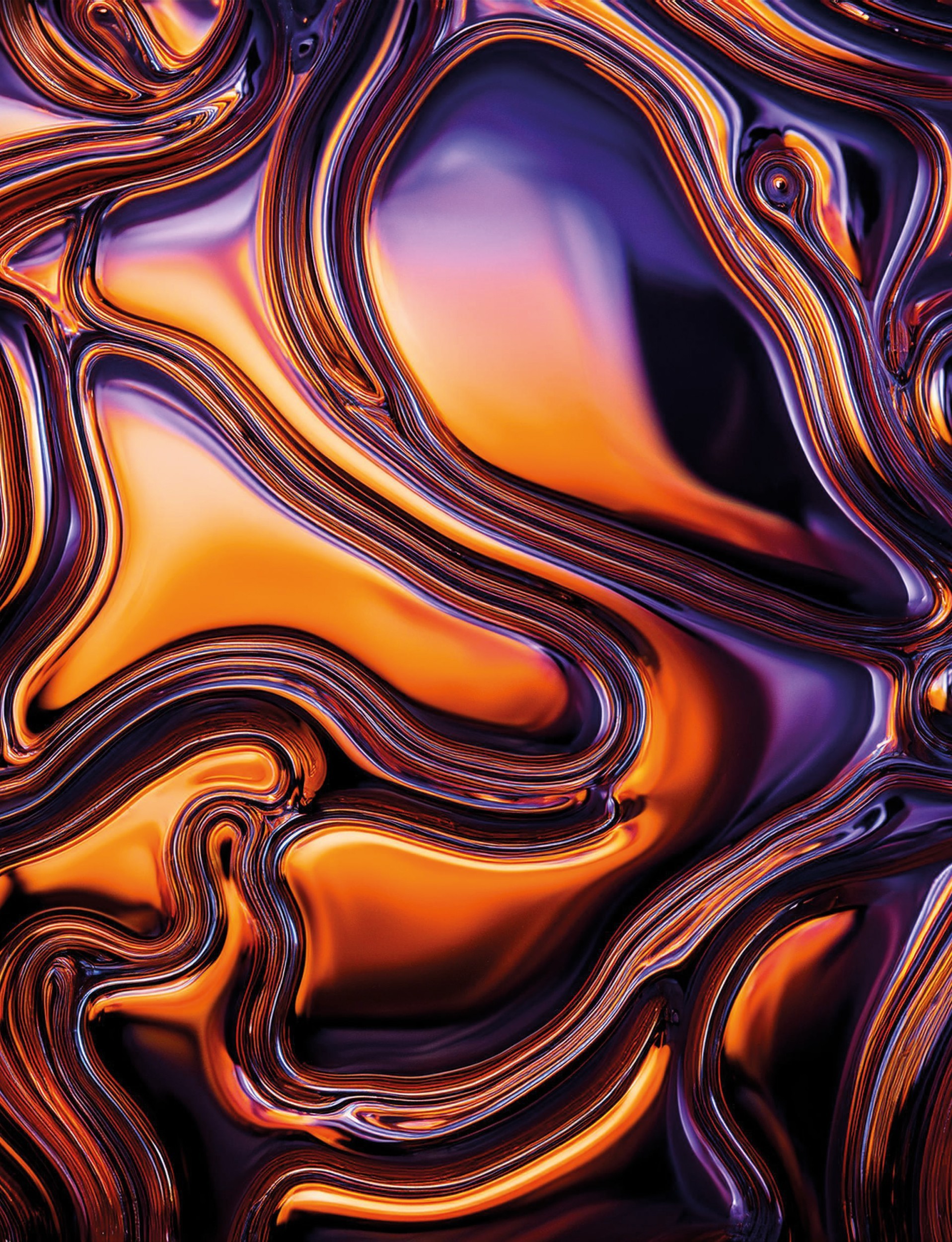La tentation aurait pu être grande de confier le mail envoyé par la rédaction de Formae à l’intelligence artificielle afin qu’elle rédige cette tribune, mais dès lors comment la signer ? Face à cette interrogation, je me suis remis à pianoter sur mon clavier. Comme pour tous pas technologiques de grande envergure – le développement de l’imprimerie par Gutenberg, l’arrivée d’Internet dans l’univers domestique à la fin des années 1990… – et de grands décentrements de l’humanité - révolutions copernicienne et darwinienne -, il est difficile de se livrer à un exercice de prévision pour un outil dont le déploiement est encore relativement balbutiant dans le monde de la création. Tout semble, en effet, opposer le secteur de l’architecture, de l’artisanat et du design à des outils qui réduiraient la singularité et l’originalité d’une proposition créative au résultat moyen d’un milliard de données brassées par des serveurs à la puissance démesurée. Une chose cependant reste sûre, le principe édicté par le prix Nobel de physique Dennis Gabor : la science avance en dépit de la morale. formulé juste après la Seconde Guerre mondiale et son lot de dévastations, cet aphorisme nous invite à l’action. Afin de mieux contrôler un nouvel outil technologique, il est nécessaire de le réfléchir en amont plutôt que de l’ignorer par crainte de ses potentialités futures. L’IA, en effet, peut effrayer, nous conduisant à penser que des pans entiers du monde du travail tel que nous le connaissons vont s’effriter au fur et à mesure de la progression de ses usages.
Au pire, les scénarios les plus noirs des films de science-fiction deviendraient des réalités, les machines seraient alors appelées à nous dépasser. Nous avons déjà connu ces inquiétudes, à titre individuel ou collectif – le bug de l’an 2000, le potentiel chômage technique engendré par l’adoption de nouveaux outils, l’impression 3D pour citer la dernière… – et même si la peur est connue pour tétaniser, Gabor nous rappelle qu’il est nécessaire de dépasser cet attentisme pour mieux connaître les possibilités offertes par une technologie naissante. Comprendre ainsi dans quels domaines elle pourrait s’appliquer afin d’exercer sur elle un contrôle, en résumé qu’elle reste un outil au service de l’homme et de son environnement.
Avant de réfléchir aux conséquences futures de l’usage de l’intelligence artificielle, regardons déjà où elle s’applique dans les professions de l’architecture, des aménagements intérieurs, du design et de l’artisanat. Quand elles sont déjà utilisées, ces solutions, parce qu’à leurs débuts, sont évidemment communes à d’autres secteurs économiques ; elles ont pour but le gain de temps. Il s’agit de la rédaction de comptes-rendus de réunions, de hiérarchisation et/ou de synthèse des données, parfois de leur traduction, voire de leur ventilation selon les différents acteurs d’un projet… Rien de bien neuf sous le soleil, mais ce temps dégagé peut être précieux dans la vie de l’entreprise. Il permet de se consacrer à des tâches à plus haute valeur ajoutée et, par voie de conséquence, d’obtenir un gain de productivité. De manière un peu plus exclusive au monde de l’architecture et de la rénovation, l’IA peut constituer une aide à la décision ou à la création d’un diagnostic. Ainsi des entreprises d’études techniques peuvent s’aider de l’IA en lui demandant d’analyser une image afin de débuter un diagnostic en la comparant à une quantité d’autres données existantes. Ce procédé est connu dans le monde médical, où une radio est préanalysée par l’IA avant que les conclusions possibles – probabilité de tumeurs, de lésions… – soient confirmées ou infirmées en dernier lieu par le médecin. C’est le même procédé qui peut être utilisé pour des désordres structurels du bâti ou pour catégoriser des pathologies de matériaux de construction déjà en place. L’AI donne une préanalyse que le technicien ou l’architecte vient valider in fine. Pour une future construction, la connaissance géologique de sols avant l’installation des fondations nécessite le plus souvent un forage, cette étape, quand le degré de précision demandée n’est pas très élevé, pourrait aussi être confiée à l’IA à condition que suffisamment de données préexistent pour le territoire où elle est projetée. Les apports de l’intelligence artificielle sont aussi nombreux en amont et en aval des chaînes de production. Mieux produire au départ – utilisation de la seule quantité nécessaire, élaboration de nouveaux matériaux, en les biosourçant par exemple…–, et mieux recycler à l’arrivée pour accélérer la transition vers une économie circulaire.
À côté de ces applications plus techniques, différents logiciels d’IA sont aujourd’hui très connus, aussi par le grand public, pour générer une ou des images types après avoir renseigné quelques mots-clés sur une ambiance, une époque, une typologie de construction, etc. Ces images d’inspiration, de mood board, touchent directement, cette fois, au processus créatif. En regard du temps long, notons tout d’abord que les notions associées plus haut dans cette tribune au travail créatif – originalité, singularité, distinction… – sont un héritage relativement récent dans notre histoire. Sans tomber dans la caricature, ces substantifs qui vont caractériser les artistes de la Renaissance sont alors les signes d’une nouvelle façon de concevoir l’acte créatif. Dans des époques antérieures, il était une affaire plus collective, l’œuvre de plusieurs compagnons, au moins d’un atelier. Des noms d’architectes, de bâtisseurs, de peintres, de sculpteurs exerçant dans les périodes pré-Renaissance nous sont bien sûr parvenus mais l’anonymat présidait en majorité à la création d’œuvres communes.. Cette perte de l’anonymat associée à la volonté de signer son œuvre, d’individualiser sa création – autant d’attitudes héritées du bouleversement des mentalités que connaît l’Europe à partir du xve siècle –, continue de croître dans les sociétés contemporaines où l’individualisme est perçu comme une valeur. Il était nécessaire de poser ces quelques jalons avant de revenir au développement actuel de l’intelligence artificielle générant des « moyennes anonymisées » à travers un panel d’images en réponse à une série de mots-clés. Dans ce cadre, l’utilisation de l’IA pourrait aussi se traduire en un gain de temps, celui habituellement consacré à la collecte de ces images d’inspiration ou à la génération d’images de synthèse et de perspectives 3D. Mais parce qu’elle touche à cet endroit à la créativité, elle soulève certaines inquiétudes. Le risque, notamment, d’observer une homogénéisation des réponses esthétiques et formelles. À la demande d’une image représentant une maison moderniste faisant la part belle à la lumière, la probabilité sera forte de vous retrouver avec un assemblage de cubes aux parois vitrées, en porte-à-faux, dominant la mer, enfin l’océan, car la majorité des modèles malaxés avant régurgitation seront pris sur la côte californienne. Comme pour un bon mood board, c’est l’intelligence de l’homme ou de la femme, ses connaissances et sa culture générale, qui éviteront cet écueil évident par la sélection des demandes formulées auprès de ChatGPT et consorts. Écueil d’autant plus navrant s’il s’applique à un seul objet ou pièce mobilière.
Revient alors la question de qui contrôle les outils d’intelligence artificielle pour éviter une coloration ou une uniformisation du tracé, un soft power insidieux, car relativement anonyme, généré par un air du temps, un mode de pensée et une vision du monde au fort tropisme anglo-saxon. Aucune acrimonie de ma part contre la côte Ouest américaine, loin de là, mais la création a tout à voir avec la diversité : diversité des approches, des processus, des matériaux… et il serait bien dommage qu’elle ne soit qu’images. Cette diversité est en effet souvent nourrie par une connaissance et un dialogue intime avec la matière, soit ce qui caractérise, entre autres, le travail de l’artisan, son apprentissage et sa manière d’exercer son métier. Alors oui à une intelligence artificielle pour dégrossir une image 3D, en affiner les rendus de textures et de matières, pour donner une idée rapide du projet à un commanditaire ou pour ensuite gérer au mieux les espaces construits, rendre le bâtiment économe et « intelligent » dans son adaptabilité (au flux de personnes, d’air, à la consommation en énergie et en eau,…) mais une intelligence artificielle sous contrôle, préservant la diversité de l’acte créatif. Car une utilisation intensive qui oblitérerait toute matérialité, passant sous silence le tangible, la réalité des matières premières, le tact comme source d’imagination, ne ferait que renforcer ce que nous vivons depuis le xixe siècle, soit un éloignement plus fort encore de la finitude de notre monde, de ce qui le constitue et qui doit nous rappeler continuellement la dignité de notre environnement. Imaginons un seul instant ce que ferait une imprimante 3D guidée par une intelligence artificielle à laquelle il aurait été demandé de créer une planète identique à la Terre. Un scénario à la Philip K. Dick certes, mais qui mérite notre attention pour continuer à penser l’IA comme un outil dont nous conservons le contrôle. •